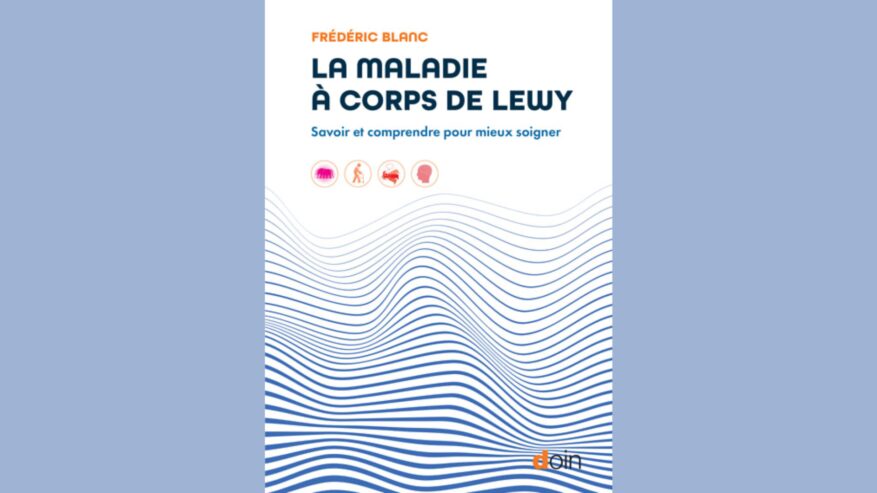Comprendre les fragilités
Maladie à corps de Lewy : que faire face au syndrome de Capgras ?


L’« illusion des sosies » touche de nombreux malades
On croirait le scénario d’un film de science-fiction, pourtant, le syndrome de Capgras est bien réel et touche des milliers de malades à corps de Lewy. Les personnes concernées sont convaincues que leur proche – ou parfois elles-mêmes – ont été remplacés par un sosie, parfois doté d’intentions malveillantes. Explications de Claire Paquet, professeure de neurologie, et Philippe de Linares, fondateur de l’Association des aidants et des malades à corps de Lewy (A2MCL).
Le syndrome a été décrit à la fin du 19ème, puis en 1923 par le psychiatre Joseph Capgras. Il l’avait alors appelé « l’illusion des sosies ».
« Il s’agit d’une curiosité neurologique pas simple à expliquer », souligne la professeure Paquet. C’est un délire, c’est-à-dire une idée fausse, qui porte sur la disparition et la substitution de personnes, y compris de soi-même. On parle alors d’auto-Capgras.
« Ce n’est ni une hallucination, ni un défaut de reconnaissance des visages », précise Claire Paquet. « Ce n’est pas non plus une maladie, mais l’expression qu’une partie du cerveau est touchée ». Fréquent dans la maladie à corps de Lewy, on le retrouve aussi dans la schizophrénie, parfois dans la maladie d’Alzheimer, la démence fronto-temporale et la maladie de Huntington.
Il naît d’une dissociation entre la familiarité perceptive (la personne est reconnue physiquement) et la familiarité affective (le lien, le sentiment que génère cette personne n’est pas reconnu). Comme les deux ne concordent pas, le malade « créée » un nouvel individu, un sosie. Parfois un jumeau. L’idée étant de réconcilier ces deux perceptions.
Le syndrome engendre beaucoup d’anxiété chez le malade, convaincu qu’un intrus se trouve chez lui, et peut entraîner des troubles du comportement, parfois violents.
Par ailleurs, le malade peut en avoir conscience, et le syndrome être très fluctuant, ajoute Philippe de Linares, qui a été confronté au syndrome.
Le sosie n’est pas toujours vu comme malveillant, mais si l’aidant est fatigué, énervé, le malade le percevra comme tel.
Il est donc essentiel, même si c’est dur, de garder son calme. Philippe de Linares conseille de :
- se souvenir que c’est la maladie qui s’exprime, pas le malade.
- éventuellement, sortir de la pièce, surtout en cas de troubles du comportement. Attendre quelques minutes à l’extérieur permet de faire retomber la tension d’un côté comme de l’autre.
- revenir en manifestant, calmement, des signes d’affection, pour aider le malade à restaurer la connexion entre ce qu’il voit et la perception affective de son aidant.
- utiliser la voix pour soutenir cette connexion. Parler gentiment de loin, à travers la porte, et pourquoi pas au téléphone peut aider.
- évoquer des souvenirs communs agréables, faire diversion.
- faire appel à un tiers si besoin pour aider le malade à se calmer.
« Évidemment, chaque situation est particulière », rappelle-t-il. « Mais le plus important c’est de rester calme et apaisé autant que possible, quelles que soient les circonstances ».
Il est en revanche inutile de chercher à corriger la perception de la personne malade, en lui disant par exemple « tu vois bien que c’est moi ».
L’AMCL a organisé le 28 avril un webinaire consacré au syndrome de Capgras. Le replay sera prochainement mis en ligne sur le site de l’association.